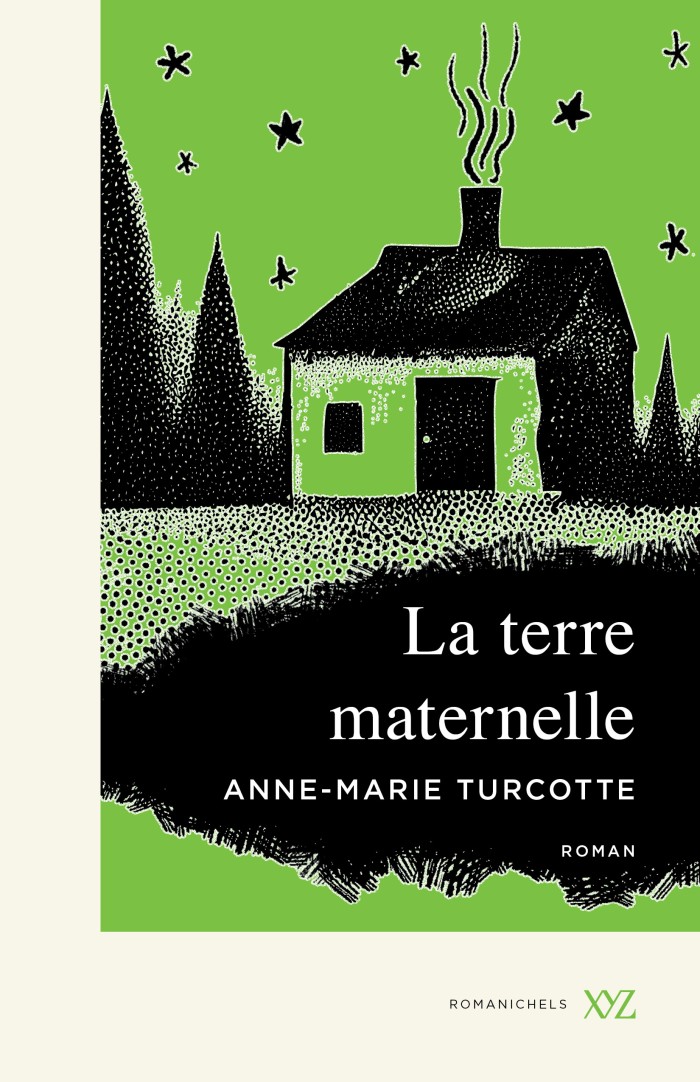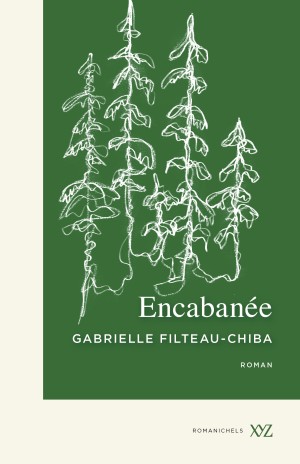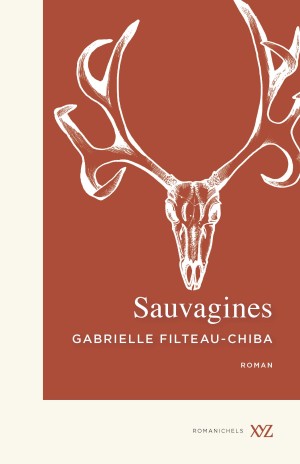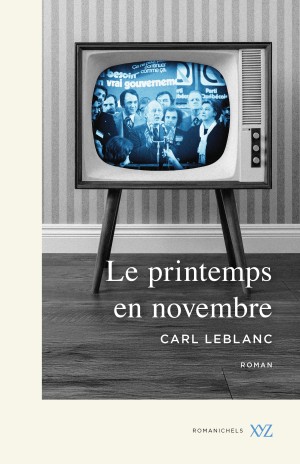Quand on grandit dans un village où la rivière ne gèle pas, la résistance de tout un peuple de Filles du Roy et de Draveurs nous coule dans les veines. On apprend à conduire sur le chemin de l’Arc-en-Ciel et on baptise son char dans la Colonie. On sait que les meilleures talles de bleuets se trouvent sur la route du Chômage. On connait les anciennes cachettes d’un célèbre contrebandier dans le Brise-Culotte. On tombe en amour sur la montagne du Fourneau. On hérite de la fertilité légendaire des femmes qui ont tapé une trail vers la revanche des berceaux.
Ces Canadiennes françaises qui ont mis au monde des trâlées d’enfants dans des conditions pas toujours idéales, ça m’impressionne pas mal plus que la face de John A. Macdonald sur le dix piasses. Ces femmes devraient être reconnues de la même manière que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Donner la vie une dizaine ou une quinzaine de fois, parfois au péril de la sienne, ça vaut autant que de donner sa vie sur un champ de bataille.
Extrait
Les grands sapins qui gardent l’entrée de la forêt me font penser aux Ents du Seigneur des Anneaux. Ils savent que je viens en paix, m’accueillent comme une vieille amie. Mes raquettes de babiche portent sur la neige fraiche. Tressées à la main par Jacques Cyr, 87 ans, de l’avenue Martin. Jusqu’au dernier moment, même sous respirateur, il a continué de fabriquer des raquettes dans son atelier. Les employés d’érablières de toute la région se les arrachent. Personne ne sait ce que M. Cyr met dans son vernis, mais quand on porte ses raquettes, on a l’impression de marcher sur l’eau comme Jésus.
Jacques Cyr est décédé le mois passé. Papa a réussi à m’obtenir sa toute dernière paire. Posséder les dernières raquettes de M. Cyr, c’est l’équivalent de posséder le dernier tableau peint par Picasso. C’est rare et ça vaut de l’or.
Si on met tout en œuvre pour sauver les animaux en danger d’extinction, pourquoi pas protéger l’expertise des artisans comme Jacques ? Si on les répertoriait sur une carte, comme on bague les animaux menacés, on arriverait peut-être à garder en vie tout ce savoir-faire en voie de disparaitre.
Cette éclaircie entre les arbres, passé la grosse roche, ça me dit quelque chose. Le paysage parait tellement différent l’hiver. Je suis déjà passée près de ce bouleau jaune avec Papa. Je me souviens de cette fois où on a marché dans le silence le plus complet. On essayait de contrôler le bruit de notre poids dans chacun de nos pas. Papa avait spotté une grosse talle de chanterelles, la dentelle orangée brillait sous le couvert des arbres. Mais les champignons poussaient en dessous d’un nid de guêpes gros comme un ballon de basket. J’avais relevé l’ourlet de mon chandail pour cueillir les chanterelles même si j’avais la chienne qu’une guêpe m’attaque. De retour à la maison, Maman avait ajouté notre cueillette à sa recette de riz sauvage.
La nature a été ma deuxième école et Papa en était le professeur. J’ai appris mes couleurs à travers les feuilles d’automne. L’ardeur au travail avec les coulées du printemps. Aucune institution aurait pu m’enseigner à estimer l’heure par la hauteur du soleil. Reconnaitre le bruant à gorge blanche par son chant. Deviner les amourettes d’un chevreu à travers les entailles d’un tronc. Espérer de beaux lendemains dans les couchers de soleil rouges.
On en parle
Mariant l’autofiction, le roman historique et la légende québécoise, le roman d'Anne-Marie Turcotte offre une lecture remplie de belles surprises. [...] Je suis encore habitée par tout l’amour qu’Anne porte au territoire et par sa façon de nous transmettre son amour de la culture québécoise et de la langue française. Elle livre un plaidoyer sincère à la nature, à sa région et à ceux et surtout celles qui l’ont bâtie et vue grandir.
— Geneviève, libraire à la Librairie-Boutique Vénus, mars 2024